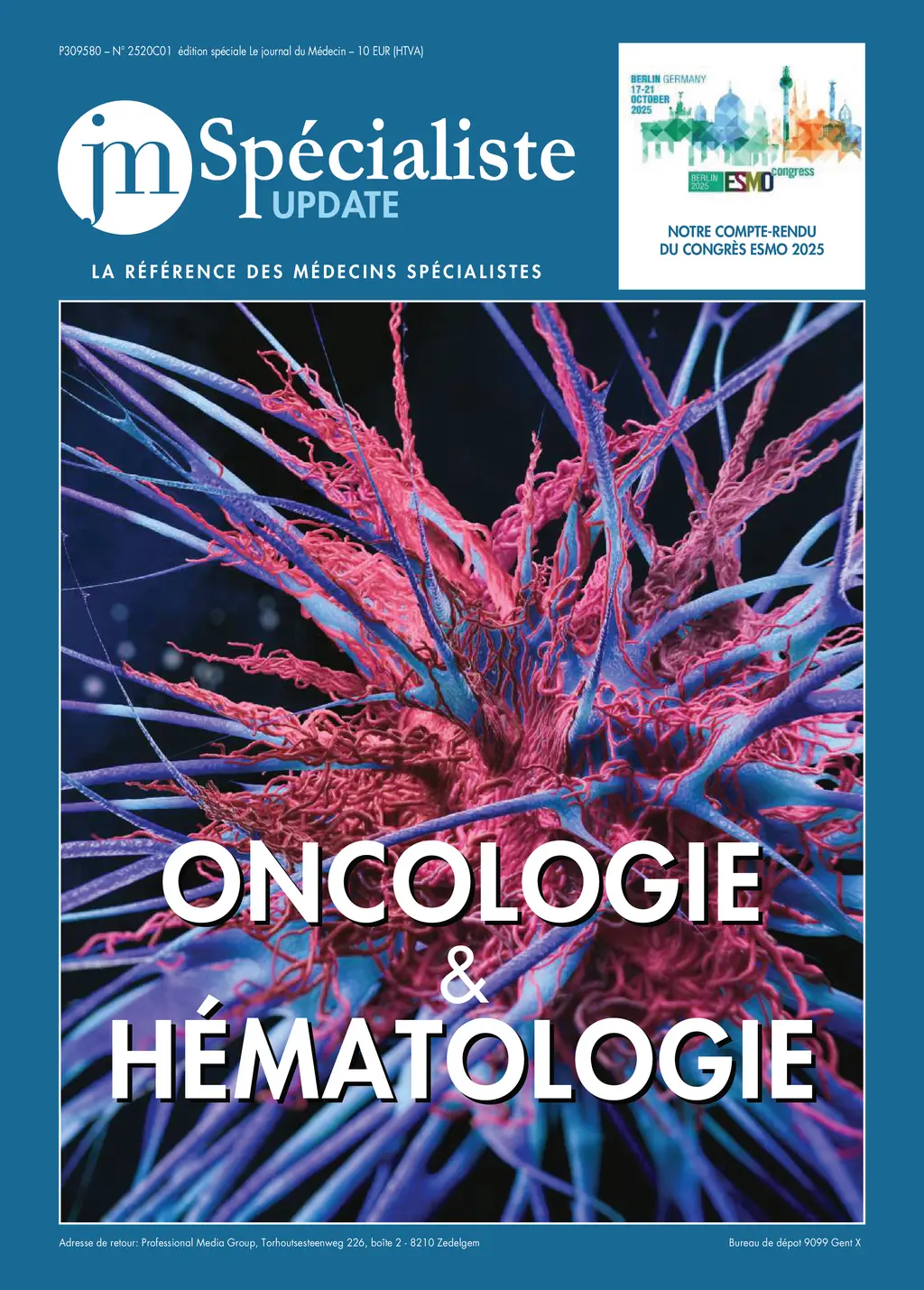Des avancées aussi dans l’insuffisance rénale diabétique
CONGRÈS EASD L’insuffisance rénale chronique (IRC) se développe chez 30 à 40 % des personnes atteintes de DT2, avec une progression potentiellement amplifiée au-delà de la simple addition des pathologies. De quoi susciter de nombreuses études pour mieux en comprendre les mécanismes et améliorer le traitement, comme l’ont montré certains exposés du 17 septembre dernier.

Les SGLT2i protecteurs contre l’atteinte tubulaire...
Les inhibiteurs du SGLT2 sont notamment connus pour atténuer efficacement l’albuminurie. Cependant, leur effet sur la protéinurie non albuminurique (PAN), un facteur de risque indépendant de la progression de la dysfonction rénale, restait jusqu’ici peu étudié. Une étude rétrospective [1] visait à déterminer cet impact chez des diabétiques de type 2 et à explorer la relation entre les variations de PAN et le taux urinaire de N-acétyl-β-D-glucosaminidase (NAG), un marqueur de lésion tubulaire proximale. Et comme la PAN traduit principalement une atteinte tubulaire plutôt que glomérulaire, les auteurs ont également examiné si son taux influençait l’effet réducteur des SGLT2i sur l’albuminurie.
L’étude a recruté 1.538 patients DT2 s’étant vu prescrire un SGLT2i. Les auteurs ont mesuré le rapport albumine/créatinine (A/C) et le rapport protéines/créatinine (P/C). Ensuite, le rapport protéines non albumine/créatinine (PNA/C) a été calculé en soustrayant l’A/C au P/C. Les participants ont été classés en quatre groupes selon l’A/C (< ou ≥ 30 mg/g) et le PNA/C (< ou ≥ 120 mg/g). Le critère principal d’évaluation était la variation du PNA/C après traitement, et la durée médiane du suivi était de 19,5 mois.
Les observations chiffrées de cette étude montrent que les SGLT2i sont capables de réduire à la fois l’albuminurie et la protéinurie non albuminurique chez les patients DT2 albuminuriques ou protéinuriques. On retiendra que, chez les non albuminuriques, ceux qui présentent un rapport un PNA/C élevé au départ et une fonction rénale conservée bénéficient sous SGLT2i d’une réduction significative du PNA/C, ce qui suggère un effet protecteur potentiel de cette classe thérapeutique contre la tubulopathie diabétique.
... et pour réparer les glomérules
Les cellules issues de la lignée rénine (CoRL) constituent une population régénératrice capable de remplacer les cellules glomérulaires essentielles détruites après une lésion, et ce processus est amplifié par l’inhibition du SGLT2. Une étude exposée au congrès visait à identifier les gènes clés impliqués dans ce processus réparateur encore mal compris, en utilisant un modèle murin d’IRC, tout en administrant quotidiennement de l’empagliflozine (10 mg/kg) pendant deux semaines [2]. Les CoRL rénales ont été isolées par cytométrie de flux et soumises à un séquençage d’ARN unicellulaire.
Le SGLT2i a amélioré la fonction rénale, avec une baisse du taux sanguin d’urée et une amélioration de l’eGFR. Les chercheurs ont observé une augmentation du nombre de cellules intraglomérulaires dérivées des CoRL, notamment des podocytes. L’inhibition du SGLT2 a également modifié le métabolisme tubulaire proximal et réduit la population fibroblastique profibrosante. L’analyse a montré une transition limitée des CoRL vers les podocytes mais une trajectoire vers un état fibroblastique, absente à l’état basal et apparaissant après lésion ou traitement. Cette trajectoire se caractérisait par une surexpression de gènes inflammatoires et de la matrice extracellulaire, et une diminution de gènes liés au développement et à la pluripotence, suggérant une perte du caractère progéniteur lors de la différenciation.
Des travaux en cours visent à mieux comprendre les mécanismes menant à une différenciation des CoRL, ouvrant la voie à des cibles potentielles pour renforcer la régénération rénale, indépendamment (ou en association) aves les SGLT2i.
Baisser la charge médicamenteuse dans l’IRC liée au DT2 ?
Traiter avec des médicaments efficaces, c’est évidemment très bien, mais l’apport récent de l’intelligence artificielle pourrait indiquer d’autres pistes profitables, quitte à modifier à terme diverses recommandations des sociétés savantes. C’est le sujet d’une étude suisse ayant montré que de meilleurs résultats pourraient être obtenus grâce à des alternatives aux associations thérapeutiques de certaines recommandations [3].
Les chercheurs ont d’abord conçu un réseau neuronal reproduisant les recommandations nationales britanniques pour la prise en charge du DT2 et de l’IRC, avec une précision de 89 %. En s’appuyant sur des données du monde réel issues des soins primaires au Royaume-Uni, une méthode d’apprentissage a été appliquée à 18.644 points décisionnels thérapeutiques, apprenant à partir des résultats cliniques comment mieux atteindre les cibles conjointes d’optimisation : réduction relative du taux d’HbA1c d’au moins 7 % pour les valeurs > 48 mmol/mol et maintien d’un eGFR non décroissant pour 30 < eGFR < 90 ml/min/1,73 m² et uACR (urine Albumin/Creatinine Ratio) < 30 mg/g sur un an.
Les valeurs de Shapley ont été utilisées sur 22.486 décisions thérapeutiques pour définir des cohortes jumelles numériques comparables dans un ensemble test indépendant, chez qui des traitements alternatifs aux recommandations ont montré des résultats significativement meilleurs (p < 0,01). Les 22.486 participants testés par ces traitements alternatifs dans le modèle (âge moyen 75 ans ; 56 % hommes ; taux moyen d’HbA1c : 8,4 %; eGFR moyen : 77 ml/min/1,73 m² ; uACR moyen : 30 mg/mmol) comprenaient 16.839 patients DT2 et 10.144 atteints d’IRC.
Deux types de traitements alternatifs proposés par l’IA ont amélioré de 14 à 17 % la probabilité de succès, tout en réduisant la charge médicamenteuse :
- L’association d’un IEC/ARA II à un SGLT2i (ΔHbA1c : −0,3 % ; ΔeGFR : +0,45 ml/min/1,73 m²), plutôt qu’une bithérapie à base de metformine (ΔHbA1c :−0,1 % ; ΔeGFR : −1,63 ml/min/1,73 m²) ;
- Passer d’une trithérapie incluant la metformine ou l’insuline (ΔHbA1c : −0,4 % ; ΔeGFR : −1,74 ml/min/1,73 m²) à une bithérapie orale (ΔHbA1c : −0,4 % ; ΔeGFR : +0,61 ml/min/1,73 m²).
Pour les auteurs de cette étude innovante, les observations issues des données réelles remettent en question une interprétation trop cloisonnée des comorbidités dans les recommandations, et elles montrent que les effets combinés des traitements ne sont pas toujours additifs - une désescalade thérapeutique peut parfois améliorer les résultats. Prudents, ils ajoutent que ce pas concret vers une médecine de précision personnalisée nécessite une confirmation par des études prospectives.
Références
1. Choi M et al. Beyond albuminuria: effects of SGLT2 inhibitors in type 2 diabetes patients with nonalbuminuric proteinuria: a retrospective cohort study.
2. Van der Pluijm LAK et al. SGLT2 inhibition modulates fate of cells of renin lineage in kidney disease
3. Gabr Z et al. Can we de-escalate pharmaco-therapies for certain patients living with type 2 diabetes and chronic kidney disease?