Intelligence artificielle et obésité : de la prédiction au traitement
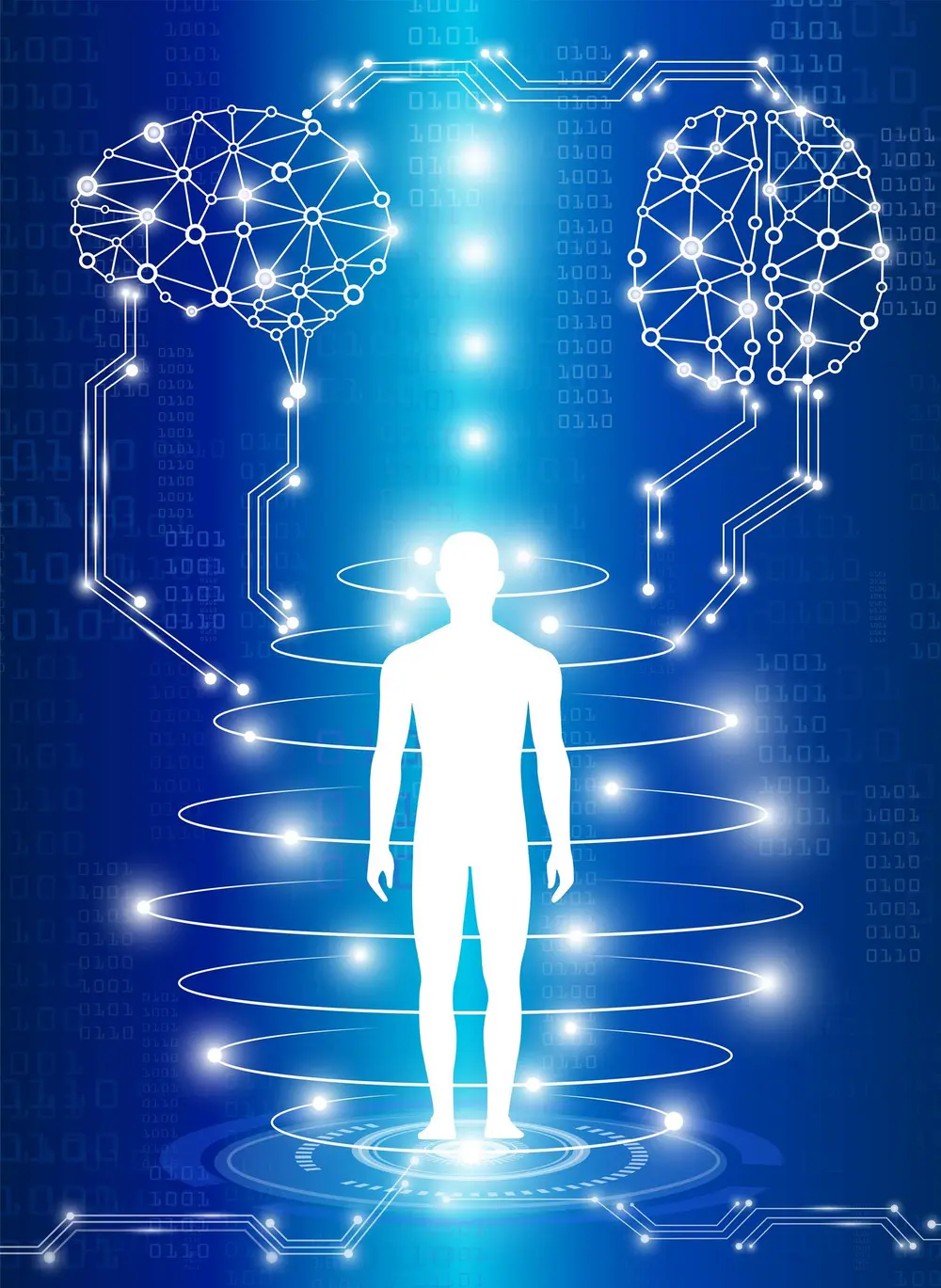 L’obésité touche déjà plus de 650 millions d’adultes dans le monde et devrait concerner un milliard de personnes d’ici 2030. Les approches classiques montrent leurs limites, tandis que l’intelligence artificielle (IA) ouvre de nouvelles perspectives : prédiction du risque, suivi personnalisé et découverte de traitements. Dans le diabète, ces outils sont déjà en pratique clinique.
L’obésité touche déjà plus de 650 millions d’adultes dans le monde et devrait concerner un milliard de personnes d’ici 2030. Les approches classiques montrent leurs limites, tandis que l’intelligence artificielle (IA) ouvre de nouvelles perspectives : prédiction du risque, suivi personnalisé et découverte de traitements. Dans le diabète, ces outils sont déjà en pratique clinique.
L’évolution de l’obésité pèse lourdement sur les systèmes de santé. Ce n’est pas un mauvais jeu de mots : l’impact économique est d’autant plus élevé que l’obésité est associée à des comorbidités majeures : diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, cancers et apnées du sommeil figurent parmi les plus fréquentes.
Les interventions classiques – modifications du mode de vie, traitement pharmacologique ou chirurgie bariatrique – restent essentielles mais montrent leurs limites. L’IA apparaît comme un nouvel outil, capable de dépasser certaines contraintes des approches actuelles. En exploitant la masse de données cliniques, biologiques et comportementales, l’IA promet d’affiner le dépistage, d’individualiser la prise en charge et d’accélérer la découverte de traitements innovants.
Prédire le risque
L’obésité est une maladie multifactorielle où interagissent prédispositions génétiques, habitudes alimentaires, comportements et environnement socio-économique. Les approches traditionnelles de prédiction reposent souvent sur l’indice de masse corporelle (IMC) et quelques variables cliniques, ce qui reste insuffisant pour anticiper l’évolution individuelle.
L’IA et le machine learning permettent de croiser ces données hétérogènes. Les algorithmes peuvent analyser simultanément des profils génétiques, des mesures issues de dossiers médicaux, des comportements captés par capteurs ou applications, et des variables sociales. « Les modèles de machine learning surpassent les approches traditionnelles pour identifier précocement les enfants à risque d’obésité », relèvent Lillian Huang et al. dans une revue récente parue dans Medicina [1].
Ces méthodes permettent de détecter des trajectoires pondérales défavorables bien avant que les complications métaboliques ne s’installent.
Ces méthodes permettent de détecter des trajectoires pondérales défavorables bien avant que les complications métaboliques ne s’installent. L’enjeu est majeur, en particulier dans l’enfance et l’adolescence, périodes critiques pour prévenir une évolution vers l’obésité adulte. Aux États-Unis, des programmes pilotes testent déjà l’IA dans des cohortes scolaires pour repérer les enfants les plus vulnérables afin d’intervenir avant que le surpoids ne s’installe.
Vers une prise en charge personnalisée
La gestion de l’obésité repose classiquement sur des recommandations générales : régime hypocalorique, activité physique accrue, suivi médical régulier. Mais l’adhésion est souvent faible, et les rechutes fréquentes. L’IA ouvre ici la perspective d’une médecine centrée sur le profil de chaque patient.
On connaît déjà la collecte des données en continu qu’a permis l’essor des capteurs connectés et des montres intelligentes. Ces informations, croisées avec les dossiers médicaux électroniques, pourraient alimenter des modèles prédictifs capables d’ajuster en temps réel les recommandations.
Un autre domaine en développement est la personnalisation nutritionnelle. L’IA peut analyser des profils métaboliques, microbiotiques ou génétiques afin de déterminer quel type de régime sera le plus efficace pour un individu donné. En Corée du Sud, des équipes universitaires développent des plateformes multimodales combinant imagerie, données biologiques et suivi connecté, avec pour objectif de guider les cliniciens vers des stratégies de perte de poids sur mesure.
Toutefois, cette promesse ne doit pas masquer certaines limites. « L’IA ne remplacera pas la relation médecin-patient. Son rôle est d’enrichir le suivi, mais l’accompagnement humain reste indispensable pour maintenir l’engagement », prévient le Pr Sarfuddin Azmi dans un article paru dans la revue Diagnostics [2].
La recherche de nouveaux traitements
 Si l’IA transforme déjà la prévention et le suivi clinique, son impact pourrait être encore plus décisif dans la recherche thérapeutique. L’obésité reste en effet difficile à traiter pharmacologiquement. Les médicaments disponibles – orlistat, agonistes du GLP-1, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine – présentent des limites : efficacité partielle, effets secondaires, coûts élevés. La plupart des patients reprennent une partie du poids perdu après l’arrêt du traitement.
Si l’IA transforme déjà la prévention et le suivi clinique, son impact pourrait être encore plus décisif dans la recherche thérapeutique. L’obésité reste en effet difficile à traiter pharmacologiquement. Les médicaments disponibles – orlistat, agonistes du GLP-1, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine – présentent des limites : efficacité partielle, effets secondaires, coûts élevés. La plupart des patients reprennent une partie du poids perdu après l’arrêt du traitement.
Dans ce contexte, l’IA est mobilisée pour accélérer la découverte de nouvelles molécules. Les techniques de criblage virtuel, couplées à l’apprentissage automatique, permettent d’analyser des millions de composés en un temps réduit. « L’IA ouvre la voie à une nouvelle génération de peptides anti-obésité, en réduisant drastiquement le temps et le coût du développement », détaille le Pr Antonio Lavecchia dans Drug Discovery Today [3].
Les agonistes des récepteurs du GLP-1, récemment popularisés, illustrent ce potentiel. L’IA est utilisée pour modéliser leur interaction avec différentes cibles, optimiser leur formulation et explorer des combinaisons thérapeutiques. Au-delà des GLP-1, des pistes émergent dans le domaine des peptides mimétiques ou des modulateurs de la signalisation neuronale de l’appétit.
L’IA est utilisée pour modéliser l'interaction des agonistes du GLP-1 avec différentes cibles, optimiser leur formulation et explorer des combinaisons thérapeutiques.
Un autre champ prometteur est celui de la modélisation in silico. Les systèmes d’IA peuvent générer des « jumeaux numériques » de patients obèses, permettant de simuler l’effet d’un médicament avant même les essais cliniques. Cette approche réduit non seulement les coûts, mais aussi les risques liés à l’expérimentation précoce.
Défis et recommandations
L’intégration de l’IA dans la lutte contre l’obésité suscite un réel engouement, mais plusieurs obstacles doivent être surmontés avant une adoption généralisée.
Le premier défi tient, comme dans beaucoup de domaines, à la qualité des données. Les algorithmes de machine learning s’appuient souvent sur des bases déséquilibrées, peu représentatives de certaines populations. « L’efficacité de l’IA dépendra de la capacité à assurer la qualité des données, à limiter les biais algorithmiques et à garantir la transparence des modèles », résume Sarfuddin Azmi.
Deuxième enjeu : la mise en œuvre clinique. Les outils d’IA nécessitent des investissements en infrastructures numériques, en cybersécurité et en formation des soignants. Leur adoption dépendra de leur intégration fluide dans le flux de travail médical, sans accroître la charge administrative.
Troisième limite : les questions éthiques et réglementaires. L’exploitation de données de santé sensibles suppose des garanties strictes en matière de confidentialité et de gouvernance. Par ailleurs, la responsabilité en cas d’erreur d’un algorithme reste un sujet non tranché.
Enfin, l’acceptabilité par les patients doit être considérée. Une partie de la population peut se montrer réticente à confier ses données ou à recevoir des recommandations automatisées.
À court terme, les experts plaident pour des projets pilotes bien évalués, intégrés aux systèmes de soins existants et assortis de validations cliniques robustes. C’est à cette condition que l’IA pourra tenir sa promesse.
Le diabète, laboratoire avancé de l’IA
Le diabète illustre déjà la façon dont l’IA peut être intégrée à la médecine de manière concrète et structurante. Alors que l’obésité est en phase d’expérimentation, le diabète constitue un terrain où même des outils non dédiés – exemple chatGPT – permettent d’aiguiller le patient qui aurait mis ses données à disposition. Avec des limites évidentes (souveraineté des données, entrainement des données dans un outil non médical, pertinence des données). Heureusement, à côté, des applications plus professionnelles et structurées existent.
Prédiction et dépistage
La prédiction du risque de diabète de type 2 a beaucoup progressé grâce aux algorithmes de machine learning. Une revue systématique par Pir Bakhsh Khokhar (Artificial Intelligence in Medicine [4]) le prouve : « Les modèles d’apprentissage automatique surpassent les méthodes classiques pour prédire le risque de diabète, grâce à leur capacité à intégrer simultanément données cliniques, biologiques et comportementales. »
Ces outils sont particulièrement utiles pour identifier les personnes à haut risque avant l’apparition de symptômes, permettant d’instaurer des mesures préventives précoces. Ils s’appliquent également au dépistage des complications, comme la rétinopathie diabétique, grâce à l’analyse automatisée d’images rétiniennes.
Biomarqueurs numériques et suivi personnalisé
Le développement de biomarqueurs numériques constitue une autre avancée majeure. En combinant données issues de capteurs multisensoriels, de dispositifs de suivi glycémique en continu (CGM) et d’analyses biologiques, l’IA permet de construire des profils individualisés.
Ces approches dépassent la simple mesure de l’hémoglobine glyquée (HbA1c), en offrant une vision dynamique de l’évolution glycémique et de la réponse aux traitements. Des dispositifs validés en clinique, comme les capteurs de glucose en continu intégrés à des algorithmes d’IA, sont déjà utilisés pour ajuster en temps réel le traitement du diabète de type 2.
Nutrition de précision et multiomics
Dans certaines situations complexes, comme le diabète chez les patients sous dialyse péritonéale, l’IA croisée aux technologies multiomics – l’approche qui combine et intègre plusieurs types de données biologiques (« omics »), au-delà de la seule génétique – ouvre la voie à une médecine de précision. L’analyse intégrée des données génétiques, métabolomiques et du microbiome permet de personnaliser les recommandations nutritionnelles. Selon Sara Mahdavi (Advances in Nutrition [5]), « l’intégration de données multiomics par l’IA permet de formuler des conseils nutritionnels hautement personnalisés, adaptés aux défis spécifiques des patients diabétiques sous dialyse ».
Recherche thérapeutique et jumeaux numériques
L’IA joue aussi un rôle clé dans la recherche de nouveaux traitements, notamment dans le diabète de type 1. Les modèles de jumeaux numériques permettent de tester des combinaisons thérapeutiques et d’optimiser les doses avant même les essais cliniques.
Ces approches accélèrent le développement de thérapies ciblées, qu’il s’agisse d’immunothérapies ou de médicaments visant à préserver la sécrétion endogène d’insuline.
Références:
1. Huang, L.; Huhulea, E.N.; Abraham, E.; Bienenstock, R.; Aifuwa, E.; Hirani, R.; Schulhof, A.; Tiwari, R.K.; Etienne, M. The Role of Artificial Intelligence in Obesity Risk Prediction and Management: Approaches, Insights, and Recommendations. Medicina 2025, 61, 358. https://doi.org/10.3390/medicina61020358
2. Azmi, S.; Kunnathodi, F.; Alotaibi, H.F.; Alhazzani, W.; Mustafa, M.; Ahmad, I.; Anvarbatcha, R.; Lytras, M.D.; Arafat, A.A. Harnessing Artificial Intelligence in Obesity Research and Management: A Comprehensive Review. Diagnostics 2025, 15, 396. https://doi.org/10.3390/diagnostics15030396
3. Amit Gangwal, Antonio Lavecchia, Artificial intelligence in anti-obesity drug discovery: unlocking next-generation therapeutics, Drug Discovery Today 2025, https://doi.org/10.1016/j.drudis.2025.104333
4. Khokhar PB, Gravino C, Palomba F. Advances in artificial intelligence for diabetes prediction: insights from a systematic literature review. Artificial Intelligence in Medicine 2025 Jun;164:103132. https://doi.org/10.1016/j.artmed.2025.103132
5. Mahdavi S, Anthony NM, Sikaneta T, Tam PY. Perspective: Multiomics and Artificial Intelligence for Personalized Nutritional Management of Diabetes in Patients Undergoing Peritoneal Dialysis. Advances in Nutrition 2025 Mar;16(3):100378. https://doi.org/10.1016/j.advnut.2025.100378
