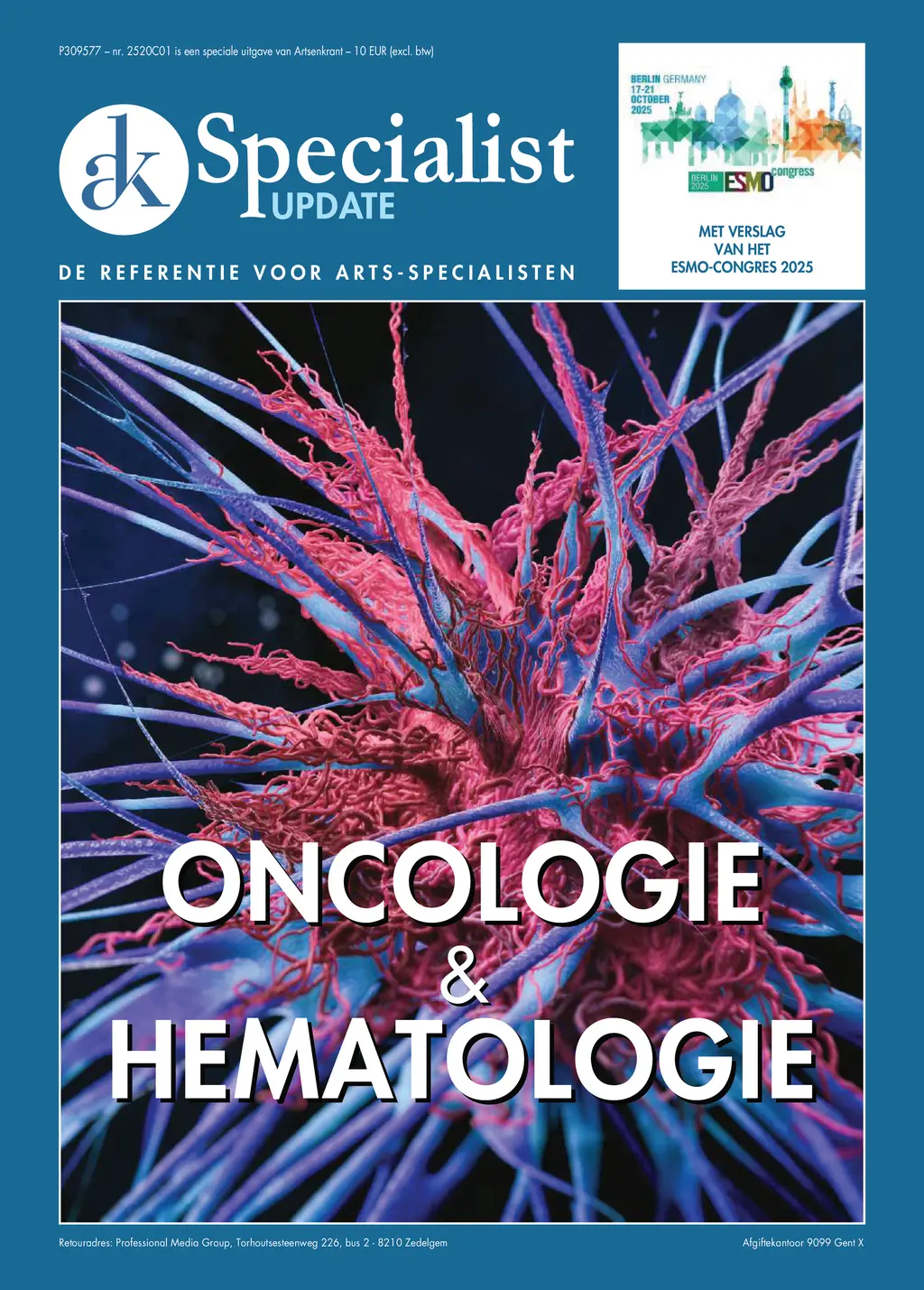Geneesmiddelenverkoop per eenheid: wat zijn de vooruitzichten in België?
Vanaf 2026 zou België kunnen experimenteren met de verkoop van geneesmiddelen per eenheid. Deze aanpak is in de eerste plaats ingegeven door ecologische overwegingen, maar zou ook de risico's van zelfmedicatie kunnen verminderen. Er zijn echter nog heel wat uitdagingen te overwinnen.

Er staat veel op het spel: "Geneesmiddelen zijn momenteel goed voor ongeveer 31% van de emissies van de gezondheidszorg", zegt Quentin Lancrenon, coördinator en woordvoerder van The Shifters, een vereniging die ijvert voor de decarbonisatie van de economie in België. Het afleveren van geneesmiddelen per eenheid (bijvoorbeeld exact het aantal voorgeschreven tabletten of capsules) is een van de mogelijke manieren om deze voetafdruk te verkleinen.
1/ Vermindering van uitstoot
Om de voordelen in termen van klimaatverandering objectief te beoordelen, gebruikten de Shifters een methodologische nota die in Frankrijk werd gepubliceerd door het Shift Project. Hierin worden antibiotica als casestudy gebruikt. Het rapport voorspelt een afname van emissies met 9,9%. Quentin Lancrenon is van mening dat deze resultaten kunnen worden vertaald naar België.
2/ Waarom beginnen met antibiotica?
De keuze voor antibiotica heeft twee redenen: er zijn veel gegevens over beschikbaar, en de voorschriften zijn voor korte, duidelijk gedefinieerde periodes. "Afleveren per eenheid zal niet voor alle geneesmiddelen gaan. Het heeft geen zin voor chronische patiënten die elke dag de medicatie moeten nemen."
Wel kan de aanpak worden uitgebreid naar andere kortdurende medicijnen zoals benzodiazepinen, anxiolytica, opioïden en pijnstillers, slaappillen, en bij de start van chronische behandelingen. Ook zijn niet alle klassen van geneesmiddelen geschikt voor verstrekking per eenheid.
De Franse studie houdt ook rekening met de impact van nieuwe verpakkingen en extra bijsluiters, om ervoor te zorgen dat de besparingen in verband met "vermeden afval" niet teniet worden gedaan door de extra logistiek van verstrekking per eenheid. Als voorbeeld beschrijft ze flessen met 1.000 tabletten die aan de apotheek worden geleverd, die vervolgens herverpakt worden in polyethyleen buisjes voor eenmalig gebruik of zakjes van kraftpapier, en afgeleverd met een ter plekke gedrukte bijsluiter.
3/ Voordelen voor de gezondheid
Afleveren per eenheid kan ook andere voordelen hebben, zoals het voorkomen van antibioticaresistentie en een verminderd risico op "restjes" die patiënten op eigen houtje innemen, soms met contra-indicaties of off-label.
Quentin Lancrenon merkt op apothekers in de praktijk al doosjes aansnijden om een patiënt uit de nood te helpen wanneer de voorraad beperkt is.
4/ Wat zijn de operationele obstakels?
De aflevering per eenheid zou gevolgen hebben voor zowel de apotheek als stroomopwaarts, in de distributie en productie. Twee mogelijke benaderingen worden genoemd: grote bussen waaruit de apotheker het exacte aantal pilletjes aflevert, of het versnijden van blisterverpakkingen. In beide gevallen zal de apotheker meer tijd nodig hebben voor de aflevering, wat de vraag oproept naar compensatie.
5/ Welke partners moeten aan tafel?
In België is een van de belangrijkste voorwaarden voor succes volgens Les Shifters een brede raadpleging van het werkveld: niet alleen apothekers maar ook het RIZIV, ziekenfondsen, artsen, de farmaceutische industrie en de afvalsector.
In dit stadium is er nog veel onduidelijkheid, zegt Caroline Ven, CEO van pharma.be. "De analyse van The Shifters is gebaseerd op een hypothetisch scenario waarin elke apotheek flessen met 1.000 pillen zou ontvangen. Aangezien deze veronderstelling ver verwijderd is van de huidige realiteit, zijn de conclusies die hieruit getrokken worden voorbarig."