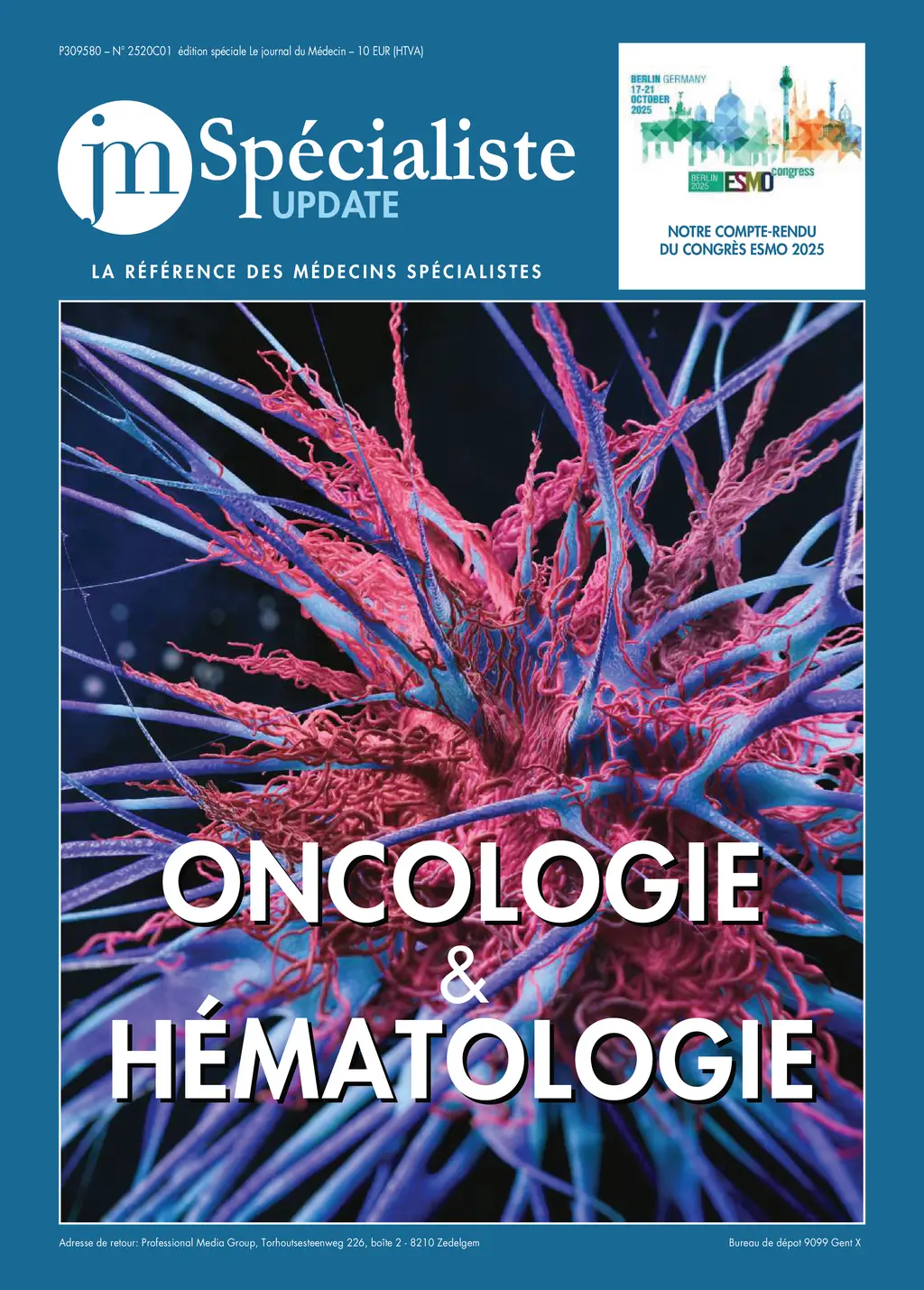Data-rata-rata
À de nombreuses reprises, diverses autorités et des entreprises privées dites mutualistes ont évoqué ou recommandé l’utilisation de « données de santé » dont elles ou diverses autres structures disposeraient.

Il s’agit par exemple de données se trouvant dans les dossiers médicaux personnels. (...) Leur exploitation devrait permettre de construire des recommandations sanitaires, voire de véritables politiques sanitaires nationales. J’ai lu, en effet, ceci : « (…) les citoyens doivent (!) jouer un rôle plus actif dans le suivi de leur santé, notamment grâce aux données qui sont - ou seront - disponibles sur diverses plateformes (…) acquérir des connaissances approfondies en vue de construire une politique appropriée … » Aucun reproche ne peut être fait au médecin de garde surchargé qui, appelé auprès d’une personne qu’il ne connaît pas, doit en quelques minutes poser un diagnostic, si celui-ci se révèle approximatif. Aucun. Même si cela mène à des erreurs. Elles sont inévitables dans de telles circonstances.
Calamités en vue
Quelques exemples réels, recueillis personnellement. Le diagnostic de ‘grippe’, en été, est parfois fort fécond : pneumonie lobaire avec épanchement pleural, hépatite A ou encore septicémie au départ d’érysipèle (deux cas). À l’inverse, une tachycardie qui était une grippe authentique. Plus surprenant, une hernie inguinale bilatérale traitée par un bandage herniaire (soigneusement confectionné par un prothésiste) qui était… une leucémie lymphoïde chronique. Pensons aussi aux dizaines de milliers d’innombrables pseudo-allergies.
Toute personne habituée à la méthode scientifique ou aux évaluations statistiques sait qu’il est primordial de définir ab initio non seulement les buts d’une étude et la méthodologie de l’analyse, mais aussi la qualité des données et la manière de les recueillir. C’est peut-être le plus essentiel. Or, rien n’y veille dans nos fumeuses « données de santé à la belge ». Rien. Et pourtant, certains prétendent bâtir une politique de santé nationale sur un tel socle. Pour les années à venir ! Quelle folie ! Quelle cascade de calamités en vue.
Si les « économistes de la santé » se dépêchent, sans doute nous imposeront-ils après-demain la sécu d’avant-hier, sans avoir même entamé la conception d’un système de santé.
Une autre prétention est de traduire en pseudo-vérités sanitaires des relevés comptables dont disposent les entreprises privées dites mutualistes et l’Inami. J’ai lu récemment ceci, issu de l’une de ces officines : « Dans les maisons de repos et de soins, 49,5 % des résidents prennent des antidépresseurs de manière régulière, 23 % « CONSOMMENT » des antipsychotiques. Ces chiffres révélés par une enquête [d’une entreprise privée dite mutualiste] montrent que la situation évolue peu ces dernières années. Pourtant, des solutions existent pour réduire le recours aux psychotropes et améliorer la santé mentale des personnes âgées. »
Relevons l’usage stigmatisant du verbe « consommer », réservé en général en matière de santé, aux toxicomanes. Charmant ! « Vous prendrez bien encore un peu de thé, chère Madame, et quelques milligrammes de Brolonium ? » Les auteurs de ces pseudo-‘études’ laissent leurs lecteurs conclure qu’il s’agit de mauvaises pratiques médicales, de toxicomanies entretenues par de médiocres soignants-dealers.
Observer le réel
Mais, comptables certes très soigneux, entre les œillères de leurs relevés de remboursement et les écrans de leurs calculettes, ils ont simplement « oublié » d’observer le réel. Par exemple, la nécessité impérative de prescrire d’énormes quantités de psychotropes aux personnes emprisonnées. À Lantin, comme en maison de repos, la vie est souvent pénible. Pourtant, les similitudes entre ces deux cohortes sont certaines. Admission à la suite d’accidents de la vie (maladie, décès du conjoint aidant, expropriation, …), passage d’un logis spacieux (70 à 80 m2 pour un appartement, beaucoup plus pour une maison) à une cellule de 12 ou 14 m2 (9 m2 en prison), perte, même, du simple choix de ses aliments… Mais non, cela n’apparaît ni dans les « données de santé à la belge », ni surtout dans la pensée de ceux qui prétendent construire sur cela la politique de santé du futur. Notre futur.
Évoquons, en passant, notre monstre du Loch Ness à nous, le cadastre des soignants du Royaume.
En conclusion, il paraît établi que se fonder ainsi sur les « données de santé à la belge » risque de mener à imposer au pays, pour de très longues années, des décisions fondées sur des données non seulement dépassées et déjà obsolètes, mais surtout recueillies par des méthodes imprécises. En clair, si les « économistes de la santé » se dépêchent, sans doute nous imposeront-ils après-demain la sécu d’avant-hier, sans avoir même entamé la conception d’un système de santé. R.I.P.