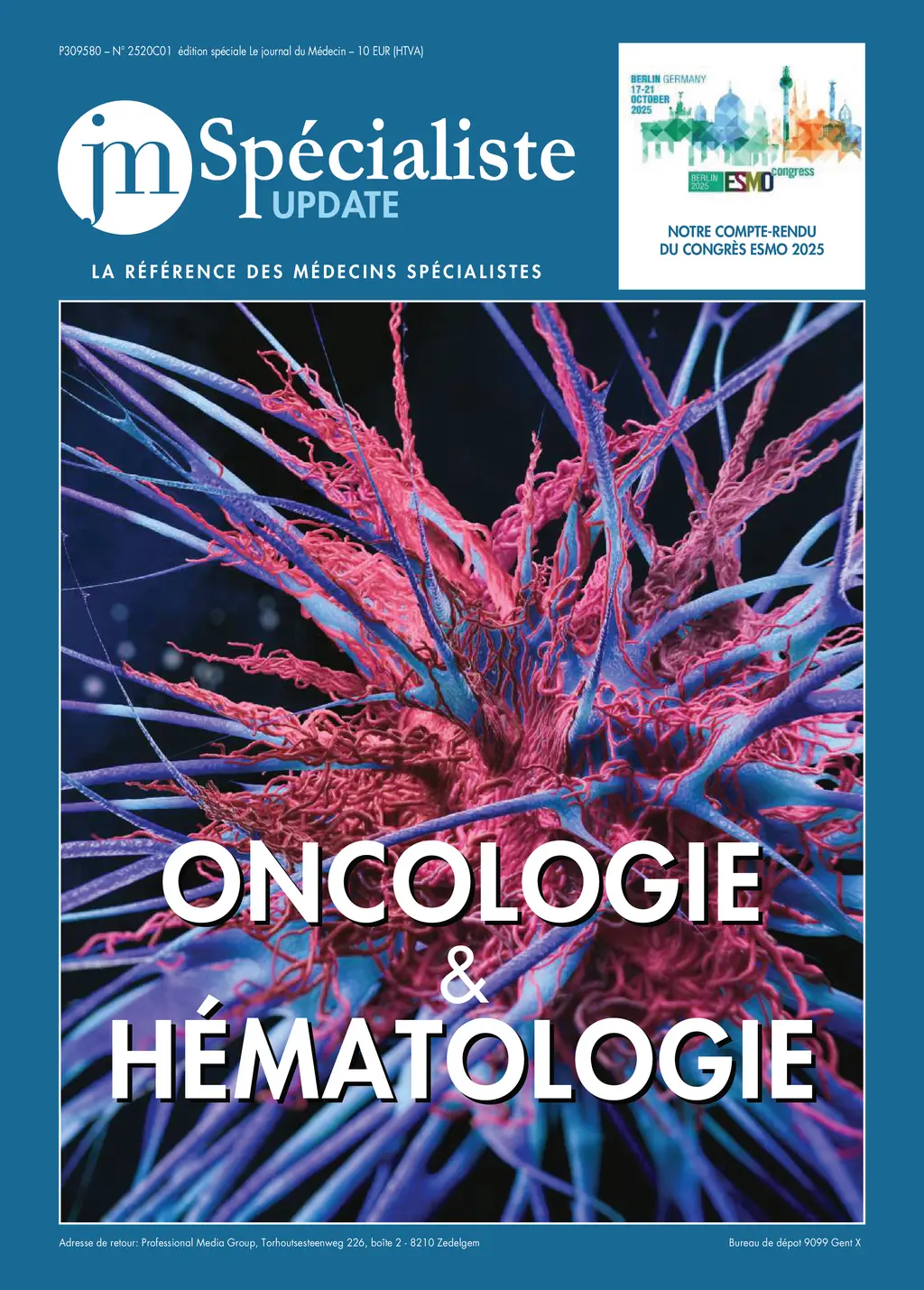L’avenir de la médecine générale
« La médecine générale est plus forte, plus innovante et plus fédératrice que jamais »
Lors de son discours à la Conférence des médecins généralistes de Domus Medica, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a insisté sur l’importance de la confiance, tout en soulignant également le rôle de l’innovation et du lien.
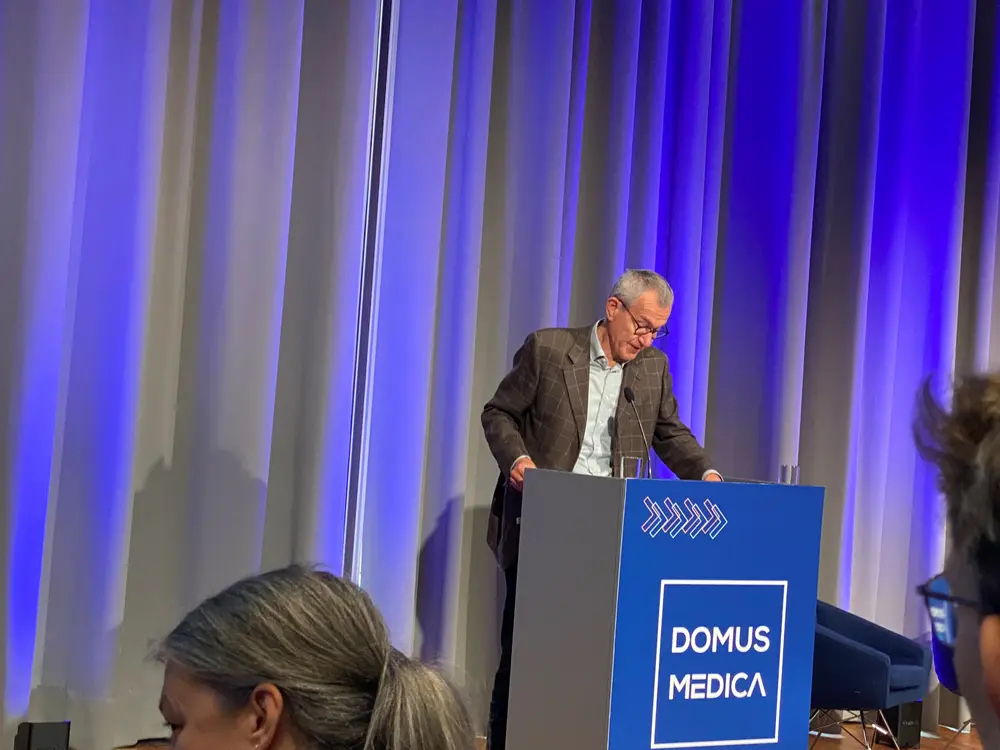 « Le médecin généraliste est le cœur de notre système de santé, le premier point de contact du patient, le guide qui l’accompagne à travers un paysage de soins de plus en plus complexe, et la personne de confiance qui l’entoure dans les moments les plus vulnérables de sa vie », a déclaré le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, lors de son discours d’ouverture à la conférence biennale des médecins généralistes de Domus Medica, qui s’est tenue samedi à Bruges.
« Le médecin généraliste est le cœur de notre système de santé, le premier point de contact du patient, le guide qui l’accompagne à travers un paysage de soins de plus en plus complexe, et la personne de confiance qui l’entoure dans les moments les plus vulnérables de sa vie », a déclaré le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, lors de son discours d’ouverture à la conférence biennale des médecins généralistes de Domus Medica, qui s’est tenue samedi à Bruges.
La confiance que les patients accordent à leur médecin généraliste constitue, selon Vandenbroucke, un élément essentiel de la profession. « Et soyons honnêtes : c’est cette confiance qui apporte souvent la guérison et la rémission, parfois plus que n’importe quel traitement. Mais cette confiance est aujourd’hui sous pression. La charge administrative augmente, les systèmes numériques sont souvent inaccessibles ou saturés, et la demande de soins croît plus vite que jamais. Parallèlement, nous observons une hausse des maladies chroniques, des besoins de soins plus complexes et une population qui vieillit, devient plus diversifiée, mais souhaite aussi rester active plus longtemps. »
Produit de consommation
Le ministre ne voit pourtant pas l’avenir de la médecine générale sous un jour sombre. « L’avenir de la médecine générale peut être plus fort, plus innovant et plus fédérateur que jamais. Cet avenir repose sur trois mots : confiance, innovation et lien. » Pour Frank Vandenbroucke, la confiance reste le mot le plus important.
Sur les réseaux sociaux et ailleurs, la recherche scientifique indépendante est de plus en plus remise en question. Les antivax disposent d’une tribune en ligne, et le président américain n’hésite pas à proférer les pires absurdités au sujet du paracétamol. « Ce climat de doute finit aussi par atteindre vos patients, ce qui vous oblige à consacrer davantage de temps à les convaincre, par exemple de l’utilité des vaccins ou de la nocivité du vapotage. »
« Parfois, les soignants perdent eux aussi confiance dans les citoyens, parce qu’une petite partie d’entre eux en est venue à considérer les soins de santé comme un produit de consommation. Un produit dont ils estiment pouvoir décider du lieu, du moment et de la personne qui doit le leur fournir. Certains patients abusent ainsi des services de garde, ne se présentent pas à leurs rendez-vous ou attendent de leur médecin des efforts irréalistes. Cela provoque, à juste titre, beaucoup de frustration chez les généralistes. Nous devons veiller à ce que cette frustration ne se généralise pas et à ne pas confondre abus délibéré et comportements liés à l’incertitude ou à la complexité du système de soins. »
Charte du bon patient
Parce que cette évolution a un impact considérable sur les médecins généralistes, Frank Vandenbroucke souhaite, par analogie avec la loi sur les droits du patient, élaborer une Charte du bon patient.
« Cette charte préciserait ce que l’on peut attendre d’un patient. Nous sommes en droit d’attendre des patients qu’ils respectent les soignants. Nous sommes en droit d’attendre qu’ils fassent preuve de patience et de compréhension lorsqu’un autre a besoin de soins plus urgents. Nous sommes en droit d’attendre qu’ils assument, dans la mesure de leurs moyens, leur part de responsabilité dans le respect des rendez-vous et des plans de traitement. »
Frank Vandenbroucke ne souhaite pas graver ces principes dans des lois ou des règlements, mais il estime essentiel de convenir de quelques règles de base pour un usage responsable des soins.
Ce n’est pas seulement entre médecins généralistes et patients que la confiance est mise à mal. Elle l’est tout autant entre les (médecins) généralistes et les autorités. Frank Vandenbroucke est revenu à ce sujet sur la polémique entourant la loi de réforme, au cours de laquelle, selon lui, de nombreuses contre-vérités ont circulé. Il a notamment fait référence à l’affirmation selon laquelle il aurait retiré les numéros Inami de médecins ne partageant pas son opinion.
La liberté thérapeutique n’est pas une liberté absolue
Une autre plainte qui se fait parfois entendre concerne l’atteinte à la liberté thérapeutique des médecins.
« Je suis un ardent défenseur de la liberté thérapeutique, mais cela ne signifie pas une liberté absolue. On est en droit d’attendre des médecins qu’ils travaillent sur base de preuves scientifiques. Les incitants à la qualité et la transparence en font partie intégrante. »
Lors des discussions budgétaires actuellement menées par le gouvernement De Wever, le secteur de la santé sera sans aucun doute dans la ligne de mire. Frank Vandenbroucke affirme n’avoir aucun tabou à ce sujet. Il a ainsi répété qu’une augmentation du ticket modérateur restait, selon lui, envisageable, à condition d’éviter qu’une telle mesure n’entraîne un report de soins nécessaires pour une partie de la population.
« N’oublions pas non plus qu’en comparaison avec d’autres pays, la part à charge du patient — en dehors de la médecine générale — figure déjà parmi les plus élevées d’Europe », a-t-il souligné.
Pour le ministre, augmenter les tickets modérateurs afin de combler de nouveaux besoins de financement n’est pas la voie à suivre. « Cela exige des réformes en profondeur du système de soins et de financement. J’espère que les partenaires sociaux, et donc aussi les syndicats médicaux, accepteront d’emprunter cette voie. »
Frank Vandenbroucke s’est également attardé sur le thème qui a dominé l’actualité de la semaine écoulée : la réintégration des malades de longue durée. « L’incapacité de travail est un problème de santé, pas un problème économique. »
Le ministre a rappelé les changements à venir pour les médecins : la limitation des certificats à trois mois maximum, l’introduction du fit note et le déploiement progressif de la plateforme TRIO, qui réunit le médecin généraliste, le médecin du travail et le médecin-conseil. « Nous voulons également élaborer un position paper sur le rôle du médecin généraliste en matière d’incapacité de travail. »
Plateforme de signalement
Des premiers échanges avec les syndicats médicaux, Frank Vandenbroucke dégage plusieurs principes :
- Le médecin traitant n’est pas un contrôleur. L’évaluation de l’incapacité de travail relève d’un jugement médical et thérapeutique, non d’une fonction de contrôle.
- Le certificat ne doit pas être le motif de la consultation. La prescription d’une incapacité de travail fait partie intégrante d’un parcours de soins et de rétablissement.
- L’incapacité de travail est un élément du traitement. Un fit note ou certificat doit s’inscrire dans une logique de rétablissement, de prévention et de réintégration.
- La reprise du travail favorise la santé. Lorsqu’elle est possible, une reprise progressive du travail fait partie du processus de guérison et d’apprentissage à vivre avec la maladie ou le handicap.
Vandenbroucke est conscient de la vive inquiétude qui règne parmi les médecins à propos du point de signalement destiné aux employeurs concernant les incapacités de travail. Il a tenu à préciser d’emblée que cette idée ne venait pas de lui, mais de certaines autres formations de la majorité.
« Mais parfois, il faut accepter un compromis. Le renforcement des compétences et la peer review constituent le cœur de ma politique. Pour pouvoir mener une évaluation par les pairs, il faut toutefois disposer de données. C’est pourquoi nous voulons créer une base de données permettant de fournir un retour individuel, comme nous le faisons déjà, par exemple, pour les prescriptions de médicaments. Par ailleurs, nous travaillons aussi à l’élaboration de fiches consacrées à certaines pathologies, afin de vous offrir des outils supplémentaires pour mieux conseiller une incapacité de travail ou une reprise partielle. » C’est sur ces mots que Vandenbroucke a conclu son allocution.