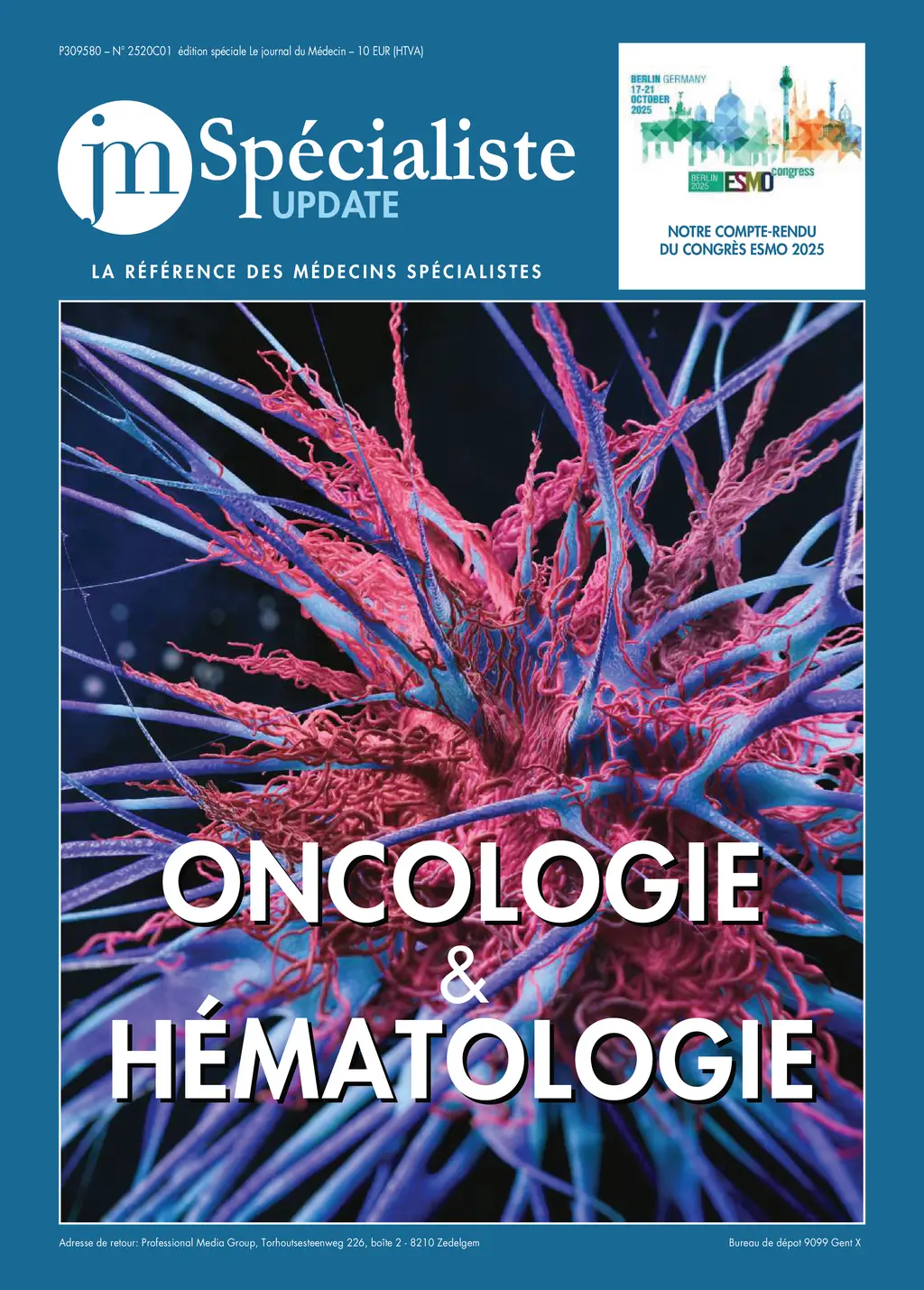Dossier Pesticides
Les agriculteurs face au dilemme pesticides
Coincés entre pressions économiques et transition écologique, les agriculteurs wallons se retrouvent au cœur d’un débat complexe. Ce deuxième volet de notre dossier "pesticides" expose leurs points de vue contrastés.
Laurent Zanella

Sous pression. C’est ainsi que de nombreux représentants du monde agricole décrivent aujourd’hui leur quotidien. Confrontés à des injonctions multiples – produire plus, avec moins d’intrants chimiques, tout en respectant des normes environnementales de plus en plus strictes –, les agriculteurs wallons doivent composer avec une équation difficile à résoudre. À la nécessaire rentabilité et aux obligations réglementaires et environnementales s’ajoutent les attentes des consommateurs…Au final, les agriculteurs se retrouvent au cœur d’un débat dont ils ne maîtrisent plus les termes.
Un modèle hérité d’après-guerre
Pour comprendre comment on est arrivé là, il faut se replonger dans l’histoire. « L’Europe, qui était en famine en 1945, s’est retrouvée en état de surproduction en 1980 – cela a été vite –, sur base de l’importation d’un modèle essentiellement porté par les États-Unis. », raconte le Pr Philippe Baret (UCLouvain). Selon lui, les pesticides, introduits en 1943, sont au cœur du basculement vers un modèle agricole dominant: « Ils sont associés à un modèle agricole d’intensification et ont participé à l’augmentation importante des rendements dans la deuxième moitié du XXᵉ siècle. »
Mais les effets délétères sur la santé et l’environnement n’ont été identifiés qu’avec un temps de retard, symbolisé par l’alerte lancée dans les années 1960 par Rachel Carson. « Ce décalage est au cœur de notre travail : comment éviter que l’on soit toujours dans cette course sans fin entre les impacts et l’utilisation des produits ? »
La course à la rentabilité
Pour la majorité des exploitants wallons, l’agriculture conventionnelle demeure aujourd’hui une nécessité économique. Benoît Haag, secrétaire général de la FWA, rappelle que les alternatives aux produits phytosanitaires restent souvent trop coûteuses, difficiles à généraliser et inégalement disponibles selon les cultures. « Ce n’est pas par plaisir qu’on sort le pulvérisateur », insiste-t-il, soulignant que le recours aux pesticides intervient en dernier ressort, faute d’autres moyens efficaces et viables dans les conditions de marché actuelles. La diminution du nombre de molécules autorisées dans l’UE, couplée à une pression concurrentielle accrue, rend l’adaptation d’autant plus complexe. Les efforts en matière de précision, de réduction de dose ou de dérive sont bien réels, mais insuffisants pour transformer profondément le modèle sans appui financier solide. « Sans budget clair pour la transition, rien ne sera possible », prévient Benoît Haag, qui appelle à un renforcement de la PAC, la Politique agricole commune de l’UE.

Même constat du côté de Hugues Falys, porte-parole de la Fédération unie de groupements d’éleveurs et d’agriculteurs (Fugea), qui dénonce une filière dominée par l’industrie, où « l’agriculteur ne fixe ni les prix ni les cahiers des charges ». À ses yeux, la dépendance aux pesticides est l’aboutissement d’un modèle productiviste hérité de l’après-guerre, renforcé par la spécialisation des cultures, la baisse du nombre d’actifs agricoles et la réforme de la PAC de 1992. Le cas de la pomme de terre est emblématique : elle mobilise jusqu’à 40 % des pesticides pour 5 % des surfaces, sous l’influence de standards industriels rigides. Pour réduire l’usage des phytos, il appelle à « une approche systémique » intégrant régulation des marchés, prix justes, recherche indépendante et meilleure répartition du risque dans la chaîne de valeur. Faute de cohérence entre niveaux de pouvoir, les agriculteurs restent seuls face à une équation impossible : produire mieux, pour moins cher, dans un marché mondialisé qui nie les coûts réels de la transition.
Les jeunes agriculteurs entre héritage et pragmatisme
La Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) défend une transition écologique réaliste, ancrée dans les contraintes économiques, sociales et techniques du terrain.
Guillaume Van Binst secrétaire général de la FJA a tenu à rappeler que la fédération « est sans ambiguïté favorable à une évolution des pratiques vers une baisse de l’utilisation des produits de protection des plantes ». Mais cette évolution, dit-il, doit être « pragmatique et intelligente », sans mettre à mal des cultures entières faute d’alternatives crédibles : « Dans la culture de la betterave, du colza, par exemple, nous savons que nous sommes à la limite de la rupture. […] Il est très compliqué, voire impossible d’être rentable sans produits phytopharmaceutiques pour certains types de cultures à l’heure actuelle.»

« Dans la culture de la betterave, du colza, par exemple, nous savons que nous sommes à la limite de la rupture. […] Il est très compliqué, voire impossible d’être rentable sans produits phytopharmaceutiques pour certains types de cultures à l’heure actuelle.»
Le risque, plus que le danger en soi, doit guider la décision : « Le danger, c’est ce que le produit peut faire. Le risque, c’est ce qui peut arriver selon la manière dont il est utilisé. » GuillaumeVan Binst a également dénoncé une certaine incohérence réglementaire : « En Belgique, 230 matières actives sont autorisées pour les produits phyto. Mais dans les encres alimentaires, on compte 5.000 substances sans norme. »
Florian Poncelet, jeune agriculteur et président de la FJA, insiste lui sur le décalage entre les attentes politiques et les réalités de terrain : « Avec du froment à 170 euros, acheter une herse étrille à plus de 80.000 euros, cela devient quand même compliqué sur une ferme moyenne. » Il déplore que « le citoyen, vous pensez à lui, mais pensez aussi au consommateur. […] N’importez plus tout et n’importe quoi ».
Les jeunes générations, assure-t-il, ne sont pas réfractaires au changement : « Dans les écoles agronomes, on voit et l’on apprend le désherbage mécanique. On apprend plus facilement comment choisir une variété […] résistante à la rouille ou autre, à la place d’acheter la variété qui donne le plus grand rendement. » Il alerte toutefois : « En supprimant certaines matières actives, on risque de ne plus avoir de non-labour qui est un plus pour la biodiversité. […] Des champignons reviennent, et d’autres microfaunes du sol qui sont plus utiles. »
Agriculture biologique : une transition possible ?
L’Union nationale des agrobiologistes belges (UNAB) plaide quant à elle pour une transition agricole plus ambitieuse, tout en reconnaissant les obstacles encore nombreux. Dominique Jacques, président de l’Unab, a tenu à raconter son histoire. Gérant d’une ferme, il a expérimenté le passage au bio à la fin des années 1990, d’abord sur 40 hectares, avant de convertir l’ensemble de l’exploitation. « Ce n’est pas si simple », résume-t-il, évoquant la recherche de débouchés, les exigences de certification. Mais il note aussi des résultats encourageants : baisse des frais vétérinaires, rendements stables, et une « autre manière de travailler ». L’expérience s’est toutefois accompagnée d’une forme d’isolement : « Avant de passer en bio, on était dans une ferme assez performante, au sens conventionnel du terme. On avait plus de 1.000 visiteurs par an. Il faut se rendre compte que du jour au lendemain où l’on est passé en bio, on n’a plus eu personne ; on ne comprend pas. »
En complément, Thierry Van Hentenryk, porte-parole de l’Unab, a présenté le bio comme une alternative « systémique, contrôlée, certifiée », définie par un cahier des charges européen strict. Il insiste sur ses co-bénéfices : santé publique, biodiversité, qualité des sols et de l’eau, réduction des émissions agricoles. Selon lui, les verrous sont d’abord économiques et psychosociaux. « Le bio est nourricier, mais il faut des filières organisées et des débouchés stables. » Il plaide pour des incitants ciblés, une commande publique orientée, une normalisation du bio dans les politiques agricoles et une plus grande reconnaissance des plus-values sociétales du modèle.
Témoignages de terrain : des voix plurielles
À travers les divers témoignages, divers constats s’imposent : les agriculteurs sont multiples et ils font face à une réalité de terrain complexe, entre contraintes économiques, injonctions environnementales et attentes de reconnaissance. Pour Daniel Coulonval, président de la FWA, « les agriculteurs sont conscients des enjeux », mais réclament des outils concrets, des études d’impact et un soutien financier pour évoluer sans mettre leur revenu en péril : « Personne ici ne joue à pile ou face avec son salaire. Pourquoi les agriculteurs devraient-ils le faire ? »
La FWA plaide pour une gestion partagée du risque, notamment via des assurances climatiques et des incitants ciblés. Le recul de l’élevage en Wallonie illustre, selon Daniel Coulonval, la difficulté d’assurer un revenu comparable : « La flamme est en train de s’éteindre », menace-t-il, évoquant le basculement vers des cultures moins risquées mais plus intensives comme la pomme de terre.
Bernard Decock, coordinateur du pôle Environnement, a quant à lui remis en perspective l’usage agricole des PFAS, estimé à moins de 1 % des volumes nationaux. Il appelle à ne pas surévaluer la responsabilité du secteur : « Il faut une approche ciblée, concertée, pas des interdictions généralisées. »
Soutenant le biomonitoring agricole mené par l’Institut scientifique de service public (Issep), la FWA demande une évaluation crédible des risques et un dialogue fondé sur des données solides : « Les agriculteurs participent. C’est sur base d’éléments concrets qu’ils peuvent adapter leurs pratiques. »
Face aux zones de non-traitement autour des habitations, la FWA alerte : interdire sur 50 mètres reviendrait à geler 87.000 hectares, soit 12 % de la surface agricole utile. Elle demande de « répartir le risque sur l’ensemble de la filière », y compris via la recherche-action, aujourd’hui trop peu valorisée.
« Ce n’est pas une trajectoire tenable »
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, l’usage des pesticides en Wallonie reste stable, autour de 1.500 tonnes par an. Malgré une succession de plans de réduction.
Pour le Pr Baret, l’explication se trouve dans des « verrouillages structurels » : politiques publiques incohérentes, poids des filières d’exportation (comme la pomme de terre, dont la production nécessite beaucoup de pesticides, lire plus bas), pression commerciale et culturelle sur les agriculteurs. « Plus de 40 % de l’usage des pesticides est destiné à l’exportation. Le récit selon lequel on en aurait besoin pour nourrir les Wallons ne tient pas », tranche l’agronome.
Appelant à agir sans attendre des données parfaites, il conclut : « Soit on agit en situation d’incertitude, soit on ne change rien. Moi, comme scientifique et comme grand-père, je pense que ce n’est pas une trajectoire tenable. »