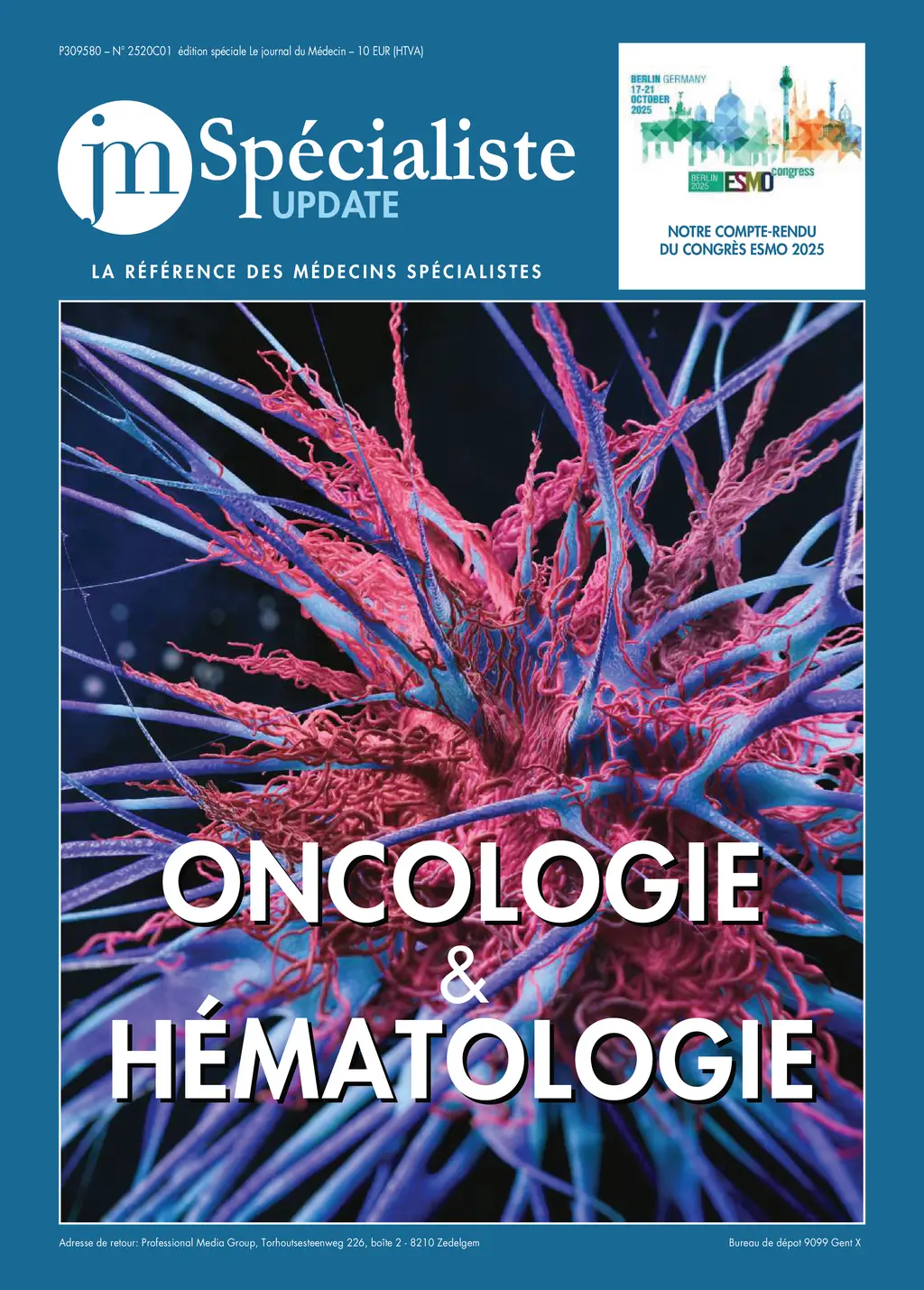Opinion
Et si on arrêtait de se mentir ?...
Le Dr Paul De Munck, président honoraire du GBO, partage son opinion sur le récent mouvement de grogne des médecins, à titre personnel.
Dr Paul De Munck (à titre personnel)
Président honoraire du GBO

Comme toute le monde le sait (ou devrait le savoir !), la sécurité sociale et le budget des soins de santé n’est pas un puit sans fond auquel chacun peut aller puiser son eau sans limite quelle que soit sa soif !
Déjà dans les années 80, le Dr André Wynen, célèbre syndicaliste médical, ancien président de l’Absym, aurait déclaré : « La sécurité sociale est un pré où chacun prélève en fonction de la largeur de sa langue ! »[1] Cette phrase illustre de manière imagée comment chaque acteur du système de santé – médecins, pharmaciens, hôpitaux, organismes assureurs, patients (?) industrie pharmaceutique, etc. – tend à défendre ses propres intérêts dans le débat sur le financement de la sécurité sociale, parfois au détriment de l’intérêt général.
Retour sur le récent mouvement de grogne
La grève historique des médecins de 1964 contre la loi Leburton[2] a eu, outre l’extension de la couverture sociale à l’ensemble de la population, au moins deux autres résultats positifs lors des accords dits de la Saint-Jean : la création du système de concertation au sein d’un Institut national maladie invalidité (Inami) entre gouvernement, médecins et organismes assureurs (OA), entre autres la commission plus connue sous le nom de « medicomut » qui fonctionne depuis 60 ans et dans les suites de la grève, la création du Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO) en 1965[3] qui, depuis 60 ans aussi, défend sans relâche sa vision politique d’une organisation des soins plaçant le médecin généraliste au centre du dispositif.
Toutes les grèves de médecins qui ont suivi n’ont plus jamais mobilisé l’immense majorité des médecins et n’ont plus eu de résultats majeurs sauf peut-être de faire reculer partiellement certaines velléités du politique qui souhaitait augmenter la pression et les contraintes sur les médecins aux fins de limiter les coûts par exemple en matière de prescriptions.
L’avant-projet de loi Vandenbroucke
L’avant-projet de loi Vandenbroucke valait-il une grève ? Manifestement pour une partie de nos consœurs et confrères, pas toujours bien informés et parfois désinformés voire manipulés, mais certainement pas pour tous les médecins du pays. Il est utile de rappeler que « la grève est un droit mais il ne faut exercer ce droit que lorsqu’elle devient un devoir ! »[4]. Et comme nous aimons à le répéter au GBO, la grève est aussi l’« Ultima Ratio Regis »[5]. Autrement dit, la dernière des armes à utiliser lorsque toutes les autres voies ont été épuisées au sein de la concertation et du dialogue politique. En l’occurrence, lors de ce nouvel épisode de tension, même si on peut reprocher au ministre de ne pas avoir coconstruit son avant-projet de loi avec les syndicats médicaux, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir ouvert la voie à la concertation même bien avant le dépôt du préavis de grève lancé par l’Absym, le 20 juin 2025 puisque, sauf erreur, l’avant-projet a été présenté au Comité de l’Assurance de l’Inami le 23 juin 2025 et que la concertation avec le Ministre a démarré le 12 juin 2025. L’Absym qui a manifestement voulu surfer sur la vague légitime d’un mécontentement global et mettre la pression en cours de négociation. Malgré les avancées significatives lors des réunions de concertation qui ont suivi, l’Absym n’a pas osé faire marche-arrière et lever son préavis de grève de peur de perdre la face.
Notons que les deux autres syndicats médicaux (le Cartel et Aadm), qui occupent tout de même cinq sièges sur les 12 à la commission médico-mutuelliste et qui représentent plus de 40 % des médecins, n’ont pas appelé à faire grève et ont opté pour privilégier la voie de la concertation ! Depuis la présentation de l’avant-projet de loi au Comité de l’assurance de l’Inami, qui pour la majorité de ses membres a renvoyé la copie au ministre, plusieurs rencontres ont eu lieu. Lors de la dernière en date du 11 juillet dernier, de l’aveu de tous les représentants présents (médecins, dentistes et OA), des avancées ont été consenties par le ministre sur les principaux points qui posaient problème. Le ministre a présenté une note résumant les changements apportés à la version de départ. Ces intentions n’ont pas suffi à rassurer le peuple médical même si le ministre est disposé à poursuivre la concertation à la rentrée parlementaire prochaine. À suivre, d’abord pour ce qui sera décidé en Kern le 21 juillet prochain et surtout pour ce qui sera repris en concertation après les congés parlementaires.
Sans revenir sur tous les points qui fâchent, il en est un qui pose le plus de problème et qui est loin d’être résolu : les fameux suppléments d’honoraires que le ministre veut plafonner à 125% pour les hôpitaux et 25% en ambulatoire.
Qui pourrait encore raisonnablement aujourd’hui s’opposer au principe de la mise en place d’un système protégeant l’accessibilité financière aux soins des patients ? Les recommandations éthiques de l’Ordre des médecins qui demandent aux médecins de faire preuve d’honnêteté et de modération[6] suffisent-elles à limiter les excès ? Les sanctions prévues pour ces excès sont-elles applicables et appliquées ? Certainement pas. Pourtant les abus existent, certes bien plus en médecine spécialisée qu’en médecine générale puisque plus de 92 % des médecins généralistes sont conventionnés en 2025. Quelles en sont les raisons ? Sans doute un désir pour certains médecins de gagner toujours plus, parfois peu soucieux du bien commun, de la santé publique et des limites financières de la majorité de la population. Mais nous devons entendre aussi les arguments avancés que, tant dans les soins ambulatoires qu’à l’hôpital, les suppléments sont là pour pallier l’insuffisance de financement des frais d’investissement et de fonctionnement. Ce n’est un secret pour personne d’ailleurs que les finances des hôpitaux sont dans le rouge. Et il est urgent d’y apporter des financements durables pour éviter que les gestionnaires soient obligés de puiser dans les honoraires des médecins et de les pousser à pratiquer des suppléments.
Le ministre, qu’on sait bien difficile à convaincre, a tout de même laissé entendre qu’il était disposé à revoir sa copie et ses pourcentages proposés si les représentants des médecins lui fournissaient des données plus précises sur ces besoins qui justifieraient ces suppléments, notamment en soins ambulatoires. Et il fera peut-être de nouvelles propositions en fonction de ce qui lui sera présenté.
Un peu de hauteur…
Mais au-delà de ces discussions sans fin sur les honoraires et les suppléments inhérentes au système de paiement à l’acte et dans le cadre des accords bisannuels, ne devrions-nous pas aussi réfléchir sur la responsabilité sociale des médecins ? La liberté diagnostique et thérapeutique est limitée par ses deux corollaires : la solidarité sociale et le sens de la responsabilité pour les acteurs du soin. Depuis plusieurs années, ce concept de la responsabilité sociale en santé est développé au sein du Rifress[7], notamment dans les facultés de santé dans le monde francophone. Si tout soignant sortant des universités et des hautes écoles était sensibilisé à ce concept durant sa formation, peut-être que l’indispensable dialogue avec les autorités sanitaires et les OA pourrait s’en trouver facilité.
N’y aurait-il pas une voie alternative à celle de la confrontation systématique entre l’État et les soignants ? Celle d’un dialogue politique et d’une concertation constructive basée sur la confiance mutuelle et sur des objectifs de soins de santé définis conjointement. Les partenaires ne seraient plus coincés dans des postures a priori concurrentielles mais plutôt complémentaires. Le rêve inaccessible ? Peut-être, mais pourquoi ne pas profiter de toutes les réformes sur la table pour tenter autre chose que le conflit permanent ? Aujourd’hui de nombreux médecins, notamment en médecine générale, restent conventionnés par conviction idéologique bien plus que par rapport aux avantages financiers qu’ils en retirent. Si les autorités politiques ont toujours la volonté de préserver notre système de soins et son accessibilité, elles ont tout intérêt à garder le système de conventionnement suffisamment attractif. Mais tous les partis politiques le souhaitent-ils encore ? Contrairement à ce qui est avancé par certains représentants de l’Absym et notamment par son tout nouveau président, Patrick Emonts, c’est le conventionnement qui a garanti jusqu’ici (et garantira demain) des soins de qualité accessibles à toutes et tous et non l’inverse !
Osons donc regarder la réalité en face et prenons nos responsabilités !
Il y va du bien-être des soignants mis à mal en ces temps de pénurie et du futur de notre système de soins au service de la communauté.
[1] Cette citation est parfois attribuée aussi à Jean-Luc Dehaene, ancien Premier ministre belge et ministre des Affaires sociales dans les années 1980.
[2] La Loi Leburton fait référence à une réforme majeure de l’assurance maladie-invalidité en Belgique, promulguée en juillet 1963 sous l’impulsion d’Edmond Leburton (1915‑1997), membre du Parti socialiste et futur Premier ministre (1973‑1974).
[3] Le GBO fêtera ses 60 ans cette année.
[4] Attribué à Georges Clémenceau.
[5] Locution latine signifiant "le dernier argument des rois". Elle est célèbre pour avoir été gravée sur les canons de Louis XIV et exprime l'idée que la force armée est le dernier recours, l'ultime moyen de faire valoir ses droits ou ses intérêts, après l'échec de la diplomatie et des négociations.
[6] Article 33 du code de déontologie de l’Ordre des médecins.
[7] Réseau international francophone de la responsabilité sociale en santé